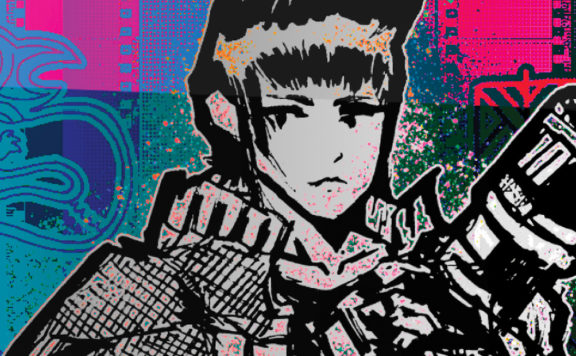Pendant une bonne moitié de sa durée, God of War Ragnarok nous a fait l’impression d’un jeu bourrin, fouilli, trop centré sur son contenu jouable, pas assez attentif à sa beauté. Si cette impression ne disparait pas totalement, les dix dernières heures (sur une trentaine) nous ont semblé de meilleure tenue sur tous les plans (narration moins lourde, combats plus vifs, level-design plus intéressant), nous laissant finalement convaincus par l’équilibre trouvé par Santa Monica Studio sur la ligne d’arrivée.
Mais il faut tout de même repartir de l’impression initiale, celle d’un game-design bourrin, qui s’organise tout entier autour de sa matière à jouer sans trop se soucier de composition visuelle ou de l’effet de cohérence de son monde. La plupart des premières zones ont en effet un aspect artificiel et fouilli, ne semblant commandées que par des impératifs ludiques – ce qu’il y aura à y faire (de la bagarre, une énigme) –, au détriment de la joliesse de leur cadre. On ne veut pas dire que le jeu est vilain : l’équipe de développement est incontestablement bourrée d’artistes de talent, dont les productions remarquables sont omniprésentes – il suffit d’observer les textures, les nombreux modèles décoratifs très fins sur les bas-côtés ou les modèles de personnages et de monstres, qui tutoient la perfection, pour s’en convaincre -. Le problème est ailleurs : dans le grand ordre du game-design, à la table des cadres planifiant la production du jeu, les artistes n’ont semble-t-il pas eu la main haute et sont resté au service de pures logiques de ludification.
Symptôme de ce game-design sans pilotage artistique, on a fréquemment « saturé visuellement », ne sachant plus où regarder dans le cadre, et pour cause : l’emploi exclusif de textures hyper précises, à la définition indifférenciée, aligne tout ce qui se présente dans le champ visuel sur un même niveau d’importance, compliquant la lecture de l’image. Ce qui fait défaut dans ces moments, c’est un travail de composition, c’est à dire de soustraction des élements qui ne contribuent pas à la beauté et à la lisibilité du cadre. Composer, pour un jeu comme pour une peinture, c’est savoir créer un contraste entre des lignes claires (le dessin d’un cours d’eau, la courbe d’un horizon, le tracé d’une route…) et des zones intriquées (une ligne de crête acérée, la texture d’une roche, des broussailles…), et le faire de manière à créer un ensemble harmonieux, équilibré, visuellement agréable. On peut en voir des exemples dans les derniers Zelda, Death Stranding, ou Ghost of Tsushima, de très beaux jeux « à paysage » qui tiennent de l’art pictural tout en étant eux aussi des jeux « à gros budget », preuve que l’un n’exclut pas l’autre, que c’est affaire de choix. A contrario, le problème de GoWR, c’est qu’il est trop souvent intriqué de partout, constitué de textures uniformément précises, ne ménageant aucun repos de l’œil, sans contraste visuel.
SI la composition n’est pas la priorité du level-design de God of War, c’est qu’une autre chose l’est : c’est la stimulation ludique permanente. Les lieux sont avant tout des espaces-en-vue-du-jeu (espaces conçus pour des combats, des énigmes ou du loot), d’où vient toute une signalétique par laquelle le game-design va communiquer ses intentions à notre égard, ce qu’il entend nous faire faire, ce qu’il attend de nous. Cette signalétique est l’élément majeur de sa composition visuelle : elle sature les espaces de marqueurs visuels incitant à l’action sous la forme de cibles (des turbines à faire tourner, des cordes à trancher d’un lancer de hache…), signifiant une énigme et, du même coup, artificialisant le monde, le vidant de sa crédibilité interne, le transformant en pur « parc-à-jeu ». L’exemple le plus grossier de cette primauté de la signalétique au service du « faire jouer » est le fléchage des parois grimpables, littéralement, sous forme de flèches peintes, l’un des « nudges » visuels le plus énormes vu dans un triple A.
On peut déplorer cette domination du fonctionnel : d’autres jeux ont montré qu’il était possible de faire autrement, en tenant compte de la « qualité » narrative et esthétique de leur monde, en n’ignorant pas que cette qualité est aussi importante dans l’expérience du joueur que la densité en trucs à faire – qualité qui peut conduire un développeur à chercher des moyens d’intégrer plus naturellement les signaux ludiques dans la diégèse du monde de jeu. L’équipe de GoWR n’y prend malheureusement pas grade, accaparée qu’elle semble être par son obsession : celle d’éviter à tout prix d’ennuyer le joueur, qu’elle semble se représenter comme un enfant incapable de fixer son attention plus de dix secondes, enfant qu’il faudrait tenir par la main (cf. les aides vocales permanentes de nos sidekick pendant les énigmes) et stimuler sans cesse en agitant la queue du Mickey pour le recapter. Dans cette obsession du « faire jouer », la composition visuelle, à visée contemplative, est logiquement reléguée aux marges, les artistes ne prenant les commandes que dans les rares et beaux « moments de vision » accompagnant les transitions (la découverte d’une zone, la sortie d’un donjon…), qui sont aussi pour le studio le moyen de faire valoir son rang de blockbuster argenté.
Cette impression de jeu bourrin, peu attentif à son esthétique dans ses décors lambda, nous a rendu la première moitié indigeste (bien que distrayante, sa formule « énigme-combat-explo » restant efficace), jusqu’à ce qu’un enthousiasme commence à poindre à la longue, notamment sur le plan de l’action. Ses combats, que l’on trouvait d’abord lourds, englués dans des animations à rallonge, finissent par trouver une certaine vitesse et nervosité par le biais d’améliorations (à choisir en montant en niveau) visant précisément à accélérer les transitions entre les phases, notamment à la hache, que nous avons favorisé. Par ailleurs, n’étant pas de grands amateurs du beat’em all tendance Devil May Cry, tout en longs combos à apprendre par cœur, on a apprécié l’approche simplifiée qu’en propose GoWR. A mi-chemin entre le matraquage de boutons qui donne quand même quelque chose visuellement (héritage des God of War sur PS2) et le combo en bonne et due forme, nos attaques se matérialisent en belles chorégraphies percutant le corps des ennemis, les projetant et les déchiquetant en un finish d’une brutalité visuellement très imagée, aussi gore que possible dans un jeu « grand public », qui offre un retour de perception « matérielle » satisfaisant. Toujours sur le plan de l’action , les boss sont également plus mémorable à mesure que l’on progresse : outre les massifs Nidhogg et Garm, dont l’animation bestiale est remarquable, on pense au génial Heimdal, notre boss préféré des deux épisodes post-reboot, sur lequel tout se met à cliquer : l’accord de sa personnalité orgueilleuse et aristo avec son gimmick ludique (on n’arrive pas à le toucher), la montée en tension de la musique à mesure qu’il sert la vis, ou encore ses charges au ralenti qu’il annonce par un « SLOW-IT-DOWN » sentencieux.
C’est enfin le level-design qui s’améliore dans les dix dernières heures, notamment celui de la jungle de Vanaheim et de son excellente zone annexe (optionnelle mais indispensable). Evoquant un donjon Zelda à ciel ouvert, cette dernière prolonge l’aventure de plus de cinq heures par une série de quêtes bien structurées, qui intègrent les puzzles dans l’environnement de façon plus organique, et nous conduisent à reconfigurer l’espace de jeu, ouvrant de nouvelles voies. Contrairement aux mondes précédents aux airs de hubs un peu vides donnant sur des « poches » de jeu en périphérie, cette zone bonus se structure en chemins partant dans tous les sens, conservant l’ouverture sans transiger sur la densité des lieux. Cette approche de la topographie (ouverte mais dense, structurée en chemins mais non linéaire) est celle qui convient le mieux aux nouveaux God of War, et permet à Ragnarok de conclure sur une note satisfaisante… d’autant que la dernière ligne droite assure le spectacle avec son duo de derniers boss réussis, et que la narration par cinématiques prend elle aussi une bonne tournure : assez lourde dans la première moitié, ponctuée de performances de style hollywoodien qui en rajoutent dans la surinterprétation psychologique (cf. les fréquentes colères hyper démonstratives), surjouant le gravité d’une histoire qui n’en méritait pas tant, la mise en scène s’allège dans un second temps en se concentrant sur le récit du voyage d’Atreus chez les dieux nordique, séquence qui enchaine les péripéties distrayantes et se laisse suivre comme une bonne série. Pour un jeu parti si lourdement, GoWR retombe donc bien sur ses pattes en retrouvant en cours de route un sens du spectacle décomplexé, un gameplay vif et un level-design dense et ouvert (à Vanaheim), qui suffisent à le recommander au-delà du divertissement ludique qu’il était garanti d’assurer, de par l’expertise du studio en la matière, et que l’on ne conteste pas.